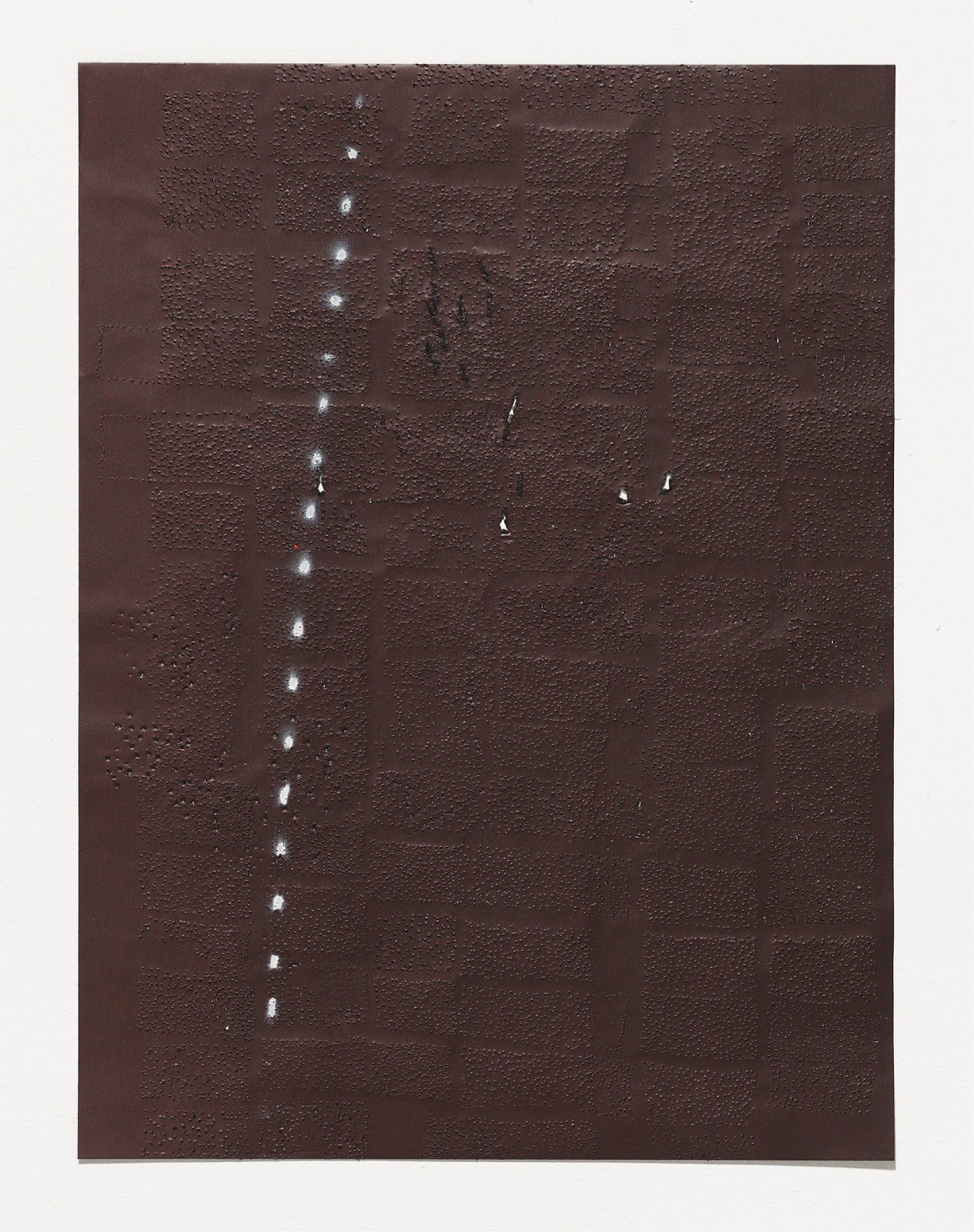« Quand résonne le silence »… Cet oxymore, titre de la dernière exposition, du peintre Nicolas Delprat, révèle un monde où l’angoisse et le doute prennent le pas sur les certitudes.
Ce titre fait pendant à un oxymore célèbre de la littérature classique, cette fameuse « obscure clarté qui tombe des étoiles », tirade du Cid de Corneille qui renvoie, certes au jeu de la lumière et de l’obscurité, part importante du travail de Nicolas Delprat, mais aussi ouvre un univers narratif et fictionnel où s’écrit en palimpseste nos angoisses contemporaines…
Cette obscure clarté, ce silence qui résonne, nous entraîne vers des routes inconnues… Que garderons-nous en mémoire à mesure que nous avançons ?
Ce qui est frappant, avant tout autre chose, dans les toiles de Nicolas Delprat, c’est l’usage de la lumière. Une relation étroite s’institue avec elle. Celle-ci est omniprésente et de formes diverses, halos, éclairages, réflexions, fenêtres, ombres portées, ambiances. La seconde chose, aussi, une forte proximité avec un écran de cinéma qui est aussi un réceptacle de lumière…
« En travaillant avec la
lumière, le plus important pour moi est de créer l’expérience d’une pensée sans
mots, de faire quelque chose de réellement tactile à partir de la qualité et de
la sensation de la lumière. Celle-ci a une qualité intangible pourtant on la
sent physiquement. Souvent, les gens tendent la main pour la toucher. Mon
travail est fait de lumière ; il est centré sur la lumière en ce sens que
la lumière est présente, qu’elle est là. On ne peut pas dire qu’il est question
de lumière dans mon travail, ni qu’il s’agit d’en raconter l’histoire, c’est de
la lumière. La lumière n’est pas quelque chose qui sert à révéler, c’est la
révélation même »
James Turrel « Mapping spaces, New-York, Peter Blum, 1987
L’on
peut dire que la lumière est une condition nécessaire à la perception des
créations artistiques qui s’adressent au sens visuel, que ce soit les arts du spectacle,
la photographie, le cinéma et bien sûr les arts plastiques. La question de la
lumière constitue en soi une part prépondérante des interrogations et des
recherches de l’histoire de la peinture ;
songeons au Caravage, à Rembrandt ou Georges De La Tour, aux
Impressionistes… Nicolas Delprat s’inscrit dans la continuité de cette
interrogation.
Bien
que figuratif, le travail pictural de Nicolas Delprat trace son sillon dans les
pas des Minimalistes, notamment ceux de Dan Flavin et James Turrel. D’ailleurs,
il n’hésite pas à s’en inspirer ou à les reprendre comme dans « Dan Flavin, acrylique sur
toile, 2006 » . La lumière, en effet, revêt une importance primordiale dans
ses tableaux, les rapports entretenus avec celle-ci sont omniprésents.
Chez Nicolas Delprat, ce travail consiste
à matérialiser les résonnances de la
lumière. Il ne tente jamais de masquer les sources lumineuses, au contraire,
celle-çi sont bien décelable, présente dans la constitution de l’image. Ces
sources, néons, halos, projections, mais aussi lumières du ciel, brouillards,
brumes nous plongent dans une atmosphère ouateuse, incertaine, aux contours
souvent peu définis. Il en saisit les phénomènes vibratoires, l’instabilité.
 |
| "Zone 26", courtesy@galerie Odile Ouizeman |
Turrel
parle de la lumière comme « la
révélation même ». Nicolas Delprat poursuit cette voie ; la
lumière chez lui devient effectivement révélation mais acquiert un statut
autre. Elle est le moyen par lequel les souvenirs refont surface, émergent de
notre inconscient.
« Nicolas Delprat
privilégie surtout une logique de représentation qui a pour objectif de
soumettre ses sources lumineuses à un traitement mnémonique et pictural. En
effet, la plupart de ses peintures parlent des souvenirs de lumières. »
Erik
Verhagen in catalogue de l’exposition « Mehr Licht », Espace Vallès,
Saint Martin d’Hyères, 2008
Avec
« Quand résonne le silence », Nicolas Delprat se distancie du Minimalisme et pousse plus loin son exploration des potentialités
cinématographiques… Pousse plus loin aussi cette impression de souvenirs
lumineux….
Plusieurs
peintres furent influencés par le cinéma ou prirent en charge les potentialités
de ce médium dans leur travaux picturaux à l’exemple de Francis Bacon qui
concentra les gros plans d’Einseinstein dans le portrait du pape Pie, de Warhol
ou encore avec la Nouvelle figuration, Monory, chassant ses sujets dans la
thématique du film noir. Nicolas Delprat, lui, s’aventure sur les terres du film
d’anticipation.
Ses
œuvres sont donc, elles aussi, habitées de références cinématographiques, où
l’on pourrait citer, Kubrick, Verhoeven, Lynch, Tarkovsky, Spielberg mais Nicolas
Delprat en explore encore une autre dimension.
L’image
cinématographique, comme on le sait, exprime un mouvement, mais celui est fait
d’images fixes, des photogrammes ; Le défilement des images provoque chez
le spectateur un effet de rémanescence, il lui fait en quelque sorte combler
les images manquantes, c’est la part illusionniste du cinéma. D’autre part, la
mémoire auditives, visuelle est mise en branle dans ce même processus afin de
rétablir une continuité visuelle mais aussi narrative car l’image qui défile
est un flux : la rémanescence des images précédentes nous permet donc
d’assurer une continuité. Notre mémoire compense en cela la perte physique des
informations. Que fait Nicolas Delprat ? Il rejoue à sa manière, ce
phénomène, avec un autre médium et il le décale dans le temps. L’expérience
proposée est un quelque sorte un visionnage en différé avec des arrêts sur
images. Que nous reste-t-il d’un film, d’une image, d’un souvenir nous revenons
toujours à cette problématique de la mémoire.
 |
| "Perspective 2", courtesy @ Galerie Odile Ouiseman |
L’utilisation
de ces références fait appel à la mémoire et par le même processus que pour les
citations de Dan Flavin ou de James Turrel, Nicolas Delprat fait immerger de
ses tableaux des images que l’on a cru voir mais qui n’existent pas réellement dans
les films référents. Là encore, il joue de notre déficience, de notre part
fantasmatique à créer ou à recréer des images à partir de ce que l’on a cru
voir, des images, qui, nous le sommes intimement persuadés, appartiennent au
film. Mais il n’en est rien. Nicolas Delprat joue donc sur ce premier registre,
d’autre part, il réussit à synthétiser dans ses tableaux une ambiance ou des
ambiances qui mêlent un ou plusieurs films. Pourrait-on parler de construction
d’images archétypales ou de stéréotypes d’images chez Nicolas
Delprat ?
Une
autre constatation importante : l’absence humaine. Nicolas Delprat, dans
les tableaux qu’il nous présente, annihile la présence humaine, du moins en
apparence. les cadres où s’inscrivent reflets, ombres de fenêtres, lueurs sont
inhabités mais Nicolas Delprat nous suggère la présence humaine en creux. En
effet, à l’observation, les paysages déserts recèlent d’une présence invisible,
fantomatique sous formes de traces : grillages, fenêtres, maisons….
 |
| "Perspective 3", courtesy @ Odile Ouiseman |
Mais
le plus intéressant est que Nicolas Delprat nous induit dans son dispositif, il
reprend à son compte le principe d’identification, certes ici l’on rétorquera
qu’il n’y a personne à qui s’identifier mais pourtant il nous met en situation
de protagoniste par un effet de caméra subjective. Cette inscription dans le
cinéma se fait aussi par des effets de travellings comme dans Ses tableaux sont construits avec l’échelle
humaine comme référent. De fait, nous nous retrouvons, en quelque sorte, dans
une position d’acteur avec toutes ses implications et ses conséquences. Ce
travail de mise en scène, ce dispositif qui implique notre participation, bien
au-delà du seul regard, nous agrège dans un monde instable et plein d’anxiété En
effet, ces paysages vides, troublés,
incertains sont de natures instables. Monde vibratoire, précaire et éphémère
des nuages, des brouillards…
Les
principales sources dans lesquelles puise Nicolas Delprat, sont la
science-fiction et l’anticipation. En effet, la plupart de ses références
cinématographique « 2001, l’Odyssée de l’espace »,
« Solaris », « Total Recall », pour ne citer que celles-ci,
appartiennent au genre de la SF. Il est à noter que la plupart des évocations
(le terme parait plus approprié que citation) tirent elles-mêmes leurs sources
de la littérature, là aussi s’instaure un jeu entre réinterprétation
cinématographique et réinterprétation picturale.
 |
| courtesy@Odile Ouiseman |
Le
genre Science-fiction nous donne, a priori, à réfléchir sur le futur, mais bien
souvent, ce discours anticipatif nous renvoie à notre présent et non à notre
futur. Il se fait témoin de notre monde. « Farenheit 451 », discours
anticipatif mais aussi regard sur les sociétés totalitaires, les exemples sont
nombreux. Nicolas delprat investit cette dimension. Il nous donne à voir des troubles, incertaines. le regard se trouve
pris au piège, dans un dispositif formelle : ce jeu avec les perspectives
dans la série éponymes où justement toutes les perspectives qui viennent
traverser le ciel, sont faussées, cette étrange intrication de plans qui se fondent,
dans la série « zones » où l’avant-plan se mêle à l’arrière-plan, où
la trame du grillage semble ne pas trouver sa place, participe au trouble de
notre vision. Ces grillages, évocation politique ? Frontières,
enfermements, camps de rétentions, univers concentrationnaire, Le film d’Alain
Resnais, « Nuit et brouillard » n’est pas loin… Mais les souvenirs se
troublent une fois encore…
 |
| courtesy @ Odile Ouiseman |
Les
tableaux de Nicolas Delprat ne reflètent-ils pas cette intuition de l’ère du
soupçon ? Un monde qui ne répond plus à nos questions ? Une métaphore
de l’homme pris dans une post-modernité, un désenchantement où rien ne vient plus suppléer à nos incertitudes, à nos
défaillances ? Quelle alternative nous reste-t-il ? Prendre une route
qui ne mène nulle part, se heurter aux grilles, aux obstacles, saisir
l’insaisissable ? Les grands récits se sont tus et seul résonne le
silence.
« Quand résonne le
silence »
Nicolas Delprat
Du 8
novembre au 12 janvier 2012
Galerie Odile Ouizeman
10/12 rue des Coutures Saint-Gervais
75003 Paris
et
aussi jusqu’au 9 décembre
« Errance »
avec Rachel Labastie
Les Salaisons
25 Avenus du Président Wilson
93230 Romainville
www.salaisons.org